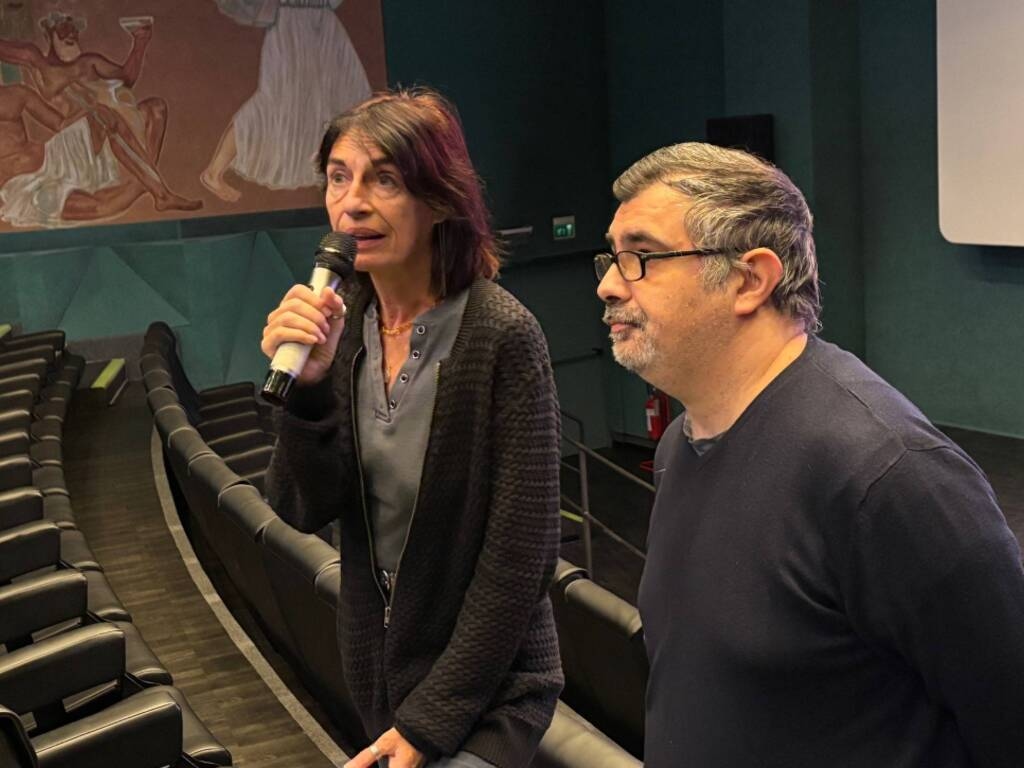Varèse – Le journalisme face au défi des algorithmes : quelles conséquences pour les lecteurs, les rédactions et les plateformes ? – Varèse News

Lors de la table ronde qui s'est tenue aujourd'hui à la salle Campiotti du festival Glocal, des chercheurs, des éditeurs, l'Ordre des journalistes et Google ont examiné comment les algorithmes, les plateformes et l'intelligence artificielle transforment l'accès à l'information , la confiance et la pérennité du travail journalistique. Les débats ont débuté par l'analyse de données italiennes issues du Digital News Report 2025, réalisé par le Master de journalisme de Turin et présenté par Paolo Piacenza.
Photographie : trop de consommation, trop peu d'intérêt Le Master de journalisme de Turin a présenté les résultats italiens du Digital News Report (échantillon YouGov, 2 008 répondants, comparés à l’Espagne, la France, la Finlande, le Royaume-Uni et les États-Unis) : en Italie, l’intérêt « élevé » pour l’actualité se situe à 39 %, en baisse sur le long terme, mais la fréquence de consommation reste parmi les plus élevées, juste derrière la Finlande, un paradoxe qui témoigne d’une consommation intense mais d’un engagement émotionnel et conversationnel en baisse.
La télévision reste la principale source (51 %) et la plus utilisée chaque semaine (66 %), les médias sociaux étant en croissance mais ne dominant pas ; en ligne, en tant qu'ensemble de sources, a dépassé la télévision en termes d'utilisation hebdomadaire, mais pas en tant que « principale source », tandis que les podcasts et les chatbots d'IA restent marginaux (6 % et 4 % pour l'information).
Accès médiatisé : l'effondrement du « direct » L'accès direct aux sites d'actualités est passé de 27 % à 16 % : les moteurs de recherche, les médias sociaux et les agrégateurs sont de plus en plus utilisés, Google News étant en tête , tandis que les notifications push sont désactivées ou non reçues par 87 % des utilisateurs, souvent parce qu'elles sont perçues comme « trop nombreuses ou peu utiles ». Sur les réseaux sociaux, Facebook est en déclin mais reste le principal utilisateur pour s'informer ; Instagram et TikTok gagnent du terrain, notamment auprès des utilisateurs de moins de 35 ans, tandis que X/Twitter n'est utilisé pour s'informer que par 5 % des utilisateurs ; les plateformes textuelles continuent de privilégier l'information au détriment du visuel, malgré la forte croissance de la vidéo.
Jeunes, créateurs et publications : qui capte l'attention ? Sur toutes les plateformes, 52 % des internautes privilégient les sources professionnelles, 37 % les créateurs et les personnalités en ligne, et 28 % les contributions « courantes » : l’attrait des sources non traditionnelles est en hausse, mais le risque perçu de désinformation associé aux créateurs et aux influenceurs l’est tout autant.
Fanpage domine l'audience en ligne ; parmi les moins de 35 ans, Fanpage est la principale source d'information pour 29 %, suivi par Repubblica, Sky, Corriere, Ansa et Il Post, dont le classement auprès des jeunes est deux fois supérieur à la moyenne nationale.
Le paiement pour l'information : un problème non résolu L'Italie reste en bas du classement des paiements numériques, avec une volonté relativement plus grande chez les jeunes (habitués à payer des services en ligne) mais déjà en baisse chez les 25-35 ans ; les payeurs sont davantage concentrés sur les « sites d'actualités » que sur les grandes marques généralistes, ce qui indique que les gens paient lorsque l'offre a une identité, de la valeur et un lien fort avec eux.
Le panel a souligné qu'il est trompeur de confondre le « marché de l'attention » avec le « marché de l'information » : les affaires prospèrent là où les produits journalistiques sont protégés dans leur identité et leur qualité, comme le démontrent des exemples de niche soutenus par la confiance et la reconnaissance.
IA générative : scepticisme à l’égard de « toute IA », ouverture à l’IA « assistée ». Si le scepticisme à l'égard des informations produites entièrement par l'IA se développe (elles sont perçues comme moins fiables et transparentes), la confiance dans l'IA en tant qu'outil journalistique reste élevée ; les utilisateurs bénéficient de traductions automatiques et de résumés utiles qui accélèrent la lecture.
Selon Google, les internautes interrogent les sources de manière inédite et plus approfondie ; grâce au mode IA, les requêtes sont 2 à 3 fois plus complexes et permettent d’orchestrer plusieurs recherches pour obtenir des réponses complexes : « l’avenir n’est pas l’IA ou le web, mais l’IA et le web », promettant ainsi une visibilité accrue, même pour les contenus de niche faisant autorité.
Les points de vue du panel : entre réalisme et stratégie Carlo Bartoli (Ordre des journalistes) a souligné le décalage entre les aspirations affichées et les comportements réels (les ragots et les interviews « légères » attirent plus de clics que les sujets qui ont un véritable impact sur la vie des gens), prédisant un possible « refuge » vers les sources traditionnelles et institutionnelles après les affaires de deepfake ; il a critiqué les médias traditionnels pour leur propension à privilégier les clichés et les histoires de coulisses, au détriment des questions environnementales et liées aux services publics.
Marco Giovannelli (directeur de VareseNews, président d'ANSO) a souligné l'importance stratégique de l'information locale et hyperlocale, l'impact important des politiques de Google sur Discover et les nouvelles fonctionnalités (AI Overviews, iMode) même pour les publications « bien connues », et la nécessité pour les journalistes de devenir de « grands connecteurs » au sein d'un écosystème où le contenu purement narratif est le plus facilement remplacé par la technologie.
Google : Pourquoi devenir partenaire et comment la recherche évolue Federico Sattanino (Google, secteur Actualités et Livres) a expliqué que ce partenariat s'inscrivait dans le cadre de vingt années de collaboration avec les éditeurs pour un écosystème durable et la transformation des produits afin de s'adapter à l'évolution des besoins des utilisateurs : des formats plus visuels, des questions en langage naturel, des réponses concises et « complexes » pour les recherches complexes, avec un engagement à maintenir le dialogue avec les éditeurs et à innover sur les deux fronts. Chaque année, des milliards de recherches sont effectuées sur Google, dont 15 % sont nouvelles : un rythme de changement qui empêche les équipes éditoriales de rester figées dans des modèles vieux de 20 à 30 ans, les obligeant à repenser leurs produits, leurs formats et leurs relations avec les lecteurs.
Local et hyperlocal : pourquoi ils sont importants (et le sont encore) Le rapport et les interventions ont confirmé un niveau élevé de confiance et d'intérêt pour l'information locale : faits divers, services d'information, culture et tout ce qui touche à la vie quotidienne ; la proximité facilite la vérification sociale (« si vous dites qu'il pleut à Varèse aujourd'hui, tout le monde le voit ») et renforce la crédibilité et les liens civiques.
Dans le domaine hyperlocal, la présence du service et la reconnaissance locale du travail sont les atouts majeurs : la durabilité reste un défi, mais une réputation fondée sur l’utilité et la qualité est le capital qui protège contre la surenchère du bruit algorithmique.
Ce qui fonctionne (ou ne fonctionne pas) en affaires Le panel s'est concentré sur deux points clés : les faibles rémunérations car le produit n'est souvent pas perçu comme unique et nécessaire ; et la publicité comme un « accessoire » qui ne peut plus dicter l'agenda éditorial comme elle le faisait dans les années 1980 et 2000.
Les modèles d'identité basés sur une confiance solide et des niches bien définies fonctionnent : une « boutique haut de gamme » vaut mieux qu'un généraliste indistinct ; vous payez là où il y a une valeur ajoutée introuvable ailleurs, des relations et une clarté des offres.
Lisez les commentairesVarese News