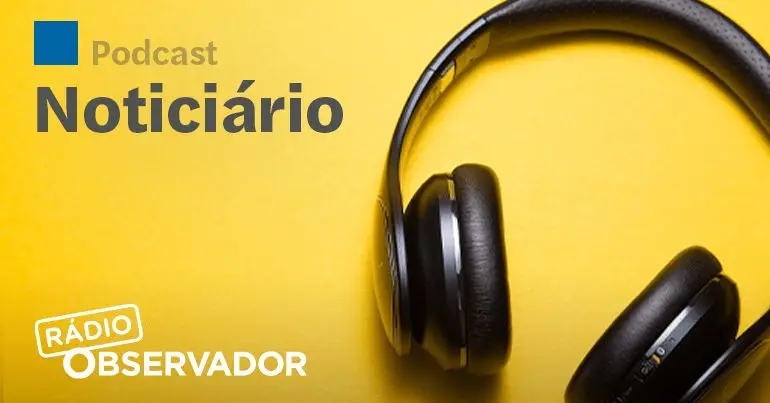Trump encercle militairement le Venezuela. Serait-ce la fin de Maduro ?

Trois destroyers équipés du système de combat Aegis, des sous-marins nucléaires, un avion de reconnaissance et un croiseur capable d'emporter des missiles guidés. Ces dernières semaines, les États-Unis ont annoncé un renforcement substantiel de leur présence militaire maritime dans les Caraïbes, notamment au large du Venezuela. Le pays dirigé par Donald Trump a justifié le renforcement de sa présence militaire par la lutte contre les cartels de la drogue dans la région , mais le président Nicolás Maduro a une opinion différente, dénonçant que Washington a l'intention de mener une opération militaire sur le territoire vénézuélien dans le but de renverser le régime au pouvoir depuis l'arrivée au pouvoir d'Hugo Chávez.
« Nous défendrons nos mers, nos cieux et nos terres. Nous les surveillerons et les patrouillerons. Aucun empire ne touchera au sol sacré du Venezuela, ni au sol sacré de l'Amérique du Sud », a proclamé Nicolás Maduro, rejetant les accusations selon lesquelles le pays qu'il dirige serait une « dictature fondée sur le trafic de drogue ». De son côté, le bureau du procureur général des États-Unis considère le président vénézuélien comme l'un des « plus grands trafiquants de drogue au monde » et une « menace pour la sécurité nationale » des États-Unis.
Les intentions des États-Unis concernant l'envoi de navires de guerre et de sous-marins nucléaires restent floues. L'administration Trump a insisté sur le fait que le président vénézuélien était un « fugitif », l'accusant de diriger le puissant Cartel de los Soles , qui se livre principalement à un trafic de cocaïne destiné ensuite aux États-Unis et à l'Europe. "Il est à la tête d'un cartel de la drogue accusé aux Etats-Unis de trafic de drogue", a déclaré la porte-parole de la Maison Blanche Karoline Leavitt, promettant que Donald Trump utilisera "toute la force américaine" pour stopper le trafic de drogue.

▲ Le cuirassé USS Lake Erie, ravitaillé en carburant au Panama avant de se diriger vers le Venezuela
AFP via Getty Images
Depuis son premier mandat, le président américain a tout mis en œuvre pour déstabiliser le régime vénézuélien, mais c'est la première fois qu'il envoie une flotte de cette taille près des côtes vénézuéliennes. Par ailleurs, le bureau du procureur général des États-Unis a annoncé mi-août une récompense de 50 millions de dollars (environ 43 millions d'euros) pour la tête de Nicolás Maduro. Il s'agit de la plus importante récompense financière jamais offerte par la justice américaine ; elle représente, par exemple, le double de celle offerte pour la capture d'Oussama Ben Laden .
Le régime vénézuélien se sent assiégé et a déjà pris ses premières mesures, mobilisant 4,5 millions de miliciens dans tout le Venezuela, ainsi que 15 000 soldats déployés à la frontière avec la Colombie. Il a également mené des opérations de lutte contre le trafic de drogue, afin de démontrer aux États-Unis qu'il ne joue aucun rôle dans les réseaux internationaux. Les États-Unis, cependant, ne montrent aucun signe de réduction de leur présence dans la région.

▲ La tête de Nicolás Maduro mise à prix, sur une affiche en Colombie
AFP via Getty Images
Le 7 août, le procureur général des États-Unis a augmenté la récompense pour toute personne fournissant des informations cruciales pour la capture de Nicolás Maduro. À l'époque, Pam Bondi avait accusé le président vénézuélien d'utiliser des « organisations terroristes étrangères » pour introduire « drogue mortelle et violence » aux États-Unis. « Sous la direction du président Trump, Maduro n'échappera pas à la justice et devra répondre de ses crimes atroces. »
Une semaine plus tard, le New York Times rapportait que le président américain avait « secrètement » demandé au Pentagone de déployer des forces militaires américaines contre des cartels d'Amérique latine qualifiés d'organisations terroristes, dont certains au Venezuela. Plus tard, le 21 août, la presse internationale révélait que le déploiement de navires de guerre visait principalement à surveiller les côtes vénézuéliennes.
Les États-Unis ont déployé trois destroyers lance-missiles de classe Aegis, avec l'intention de les positionner « pour plusieurs mois » au large des côtes vénézuéliennes. Un sous-marin nucléaire, un avion de reconnaissance P8 Poséidon, un navire de guerre équipé de missiles et d'autres navires de petite et moyenne taille ont également été déployés pour mener à bien cette mission. Les États-Unis ont également déployé 4 500 militaires et 2 220 Marines près des côtes vénézuéliennes.

▲ Destroyers lance-missiles de classe Aegis
MARINE SUD-CORÉENNE/YONHAP/EPA
Cependant, les destroyers et autres navires ont dû faire face à un imprévu : l’ouragan Erin. En raison de conditions météorologiques défavorables, la flotte a dû regagner les ports américains. Cependant, ce lundi, ils ont repris la haute mer et font désormais route vers les eaux vénézuéliennes, après avoir déjà pénétré dans le sud des Caraïbes jeudi. Par ailleurs, Reuters a rapporté que les États-Unis renforceraient leur présence militaire au large des côtes vénézuéliennes en envoyant un autre sous-marin nucléaire et le croiseur lance-missiles USS Lake Erie.
Il s'agit d'une véritable démonstration de force américaine qui pourrait causer des dommages considérables à la marine vénézuélienne, nettement plus faible que celle des États-Unis. Le régime de Nicolás Maduro s'attend à ce que les navires de guerre arrivent dans ses eaux territoriales en début de semaine prochaine, ce qui alimente les menaces et les appels à un réexamen de la décision de l'administration Trump. « Pas de sanctions, pas de blocus, pas de guerre psychologique, pas de harcèlement. Ils n'ont pas pu et ne pourront pas. Ils ne peuvent absolument pas entrer au Venezuela », a assuré le dirigeant vénézuélien.
John Polga-Hecimovich, professeur de sciences politiques à l'Académie navale des États-Unis et expert des affaires latino-américaines, a déclaré à Observador qu'il s'agissait de « l'un des plus importants déploiements de forces navales dans le sud des Caraïbes depuis des décennies ». Au total, 6 700 Américains seront mobilisés pour cette mission dans les eaux vénézuéliennes. L'expert compare également ces chiffres à ceux de l'invasion américaine de la Grenade en 1983 (7 000 soldats) et de l'invasion américaine du Panama en 1989 (30 000).
Les États-Unis peuvent-ils vraiment attaquer le Venezuela ou tuer Maduro ???????Norfolk, #États-Unis (??????????)
Les actifs de la 22e unité expéditionnaire des Marines (MEU) sont chargés dans l'USS Iwo Jima (LHD-7) de l' @USNavy au large des côtes de Virginie alors qu'elle se prépare à atteindre la côte du #Venezuela (?????????).
????: @USNavy https://t.co/e1Ud0dO6JZ pic.twitter.com/q8WXZvuch9
– SA Defensa (@SA_Defensa) 20 août 2025
Ces chiffres sont « significatifs », admet John Polga-Hecimovich. Cependant, le professeur d'université ne les estime pas suffisants pour une « invasion » américaine du Venezuela. « Si un président américain décidait un jour d'envahir le Venezuela, il faudrait un porte-avions, un soutien substantiel et des dizaines de milliers de soldats pour mener à bien la mission », explique-t-il, ajoutant que les Américains auraient besoin du soutien de certains « alliés régionaux » – comme la Colombie ou le Brésil – pour fournir « des troupes, du matériel et un soutien logistique ».
Pourtant, la Maison-Blanche reste opaque quant à son action au Venezuela . Jeudi, la porte-parole du président américain n'a pas répondu directement à la question de savoir s'il y aurait une attaque directe contre des cibles situées sur le territoire vénézuélien. « Je ne vais pas anticiper le président », a-t-elle simplement ajouté, renforçant l'idée que Donald Trump est « prêt à utiliser tous les moyens de la puissance américaine pour stopper l'entrée de drogue dans le pays et traduire les responsables en justice ».
Karoline Leavitt a toutefois souligné que « plusieurs pays des Caraïbes et de la région » ont « salué » les efforts des États-Unis pour combattre le gouvernement, qui, selon elle, est un « cartel narcoterroriste ». La porte-parole de la Maison Blanche a insisté sur une autre idée : le président vénézuélien n'est pas « légitime », surtout après les élections présidentielles de l'année dernière, où la légalité de la victoire de Nicolás Maduro a été mise en doute, contestée par l'opposition menée par María Corina Machado.
« Donald Trump est prêt à utiliser tous les éléments de la puissance américaine pour stopper l’entrée de drogue dans le pays et traduire les responsables en justice. »
Karoline Leavitt, attachée de presse de la Maison Blanche
Selon Axios , on ne sait pas encore ce que fera Donald Trump. Même les plus extrémistes n'ont pas d'idée précise des prochaines mesures du président concernant le Venezuela. « Il s'agit à 105 % de narcoterrorisme, mais si Maduro quitte le pouvoir, personne ne pleurera », affirme une source proche de la présidence. Une autre source rapporte que la présidence a demandé un éventail d'options et les évalue actuellement. « En fin de compte, c'est la décision du président, mais Maduro devrait se faire foutre. »
Pour l'instant, selon la plupart des sources interrogées par Axios, l'espoir à la Maison Blanche est que Nicolás Maduro renonce au pouvoir ou soit assassiné par des membres de l'opposition. Parallèlement, selon le même journal, la possibilité de recourir à des frappes de drones pour tuer le président vénézuélien n'est pas exclue , même si plusieurs membres de l'administration mettent en garde contre une telle solution extrême. Il s'agit donc d'une situation d'ambiguïté stratégique.
Mais quelqu'un pourrait tout changer : Marco Rubio . Le secrétaire d'État américain et actuel membre du Conseil de sécurité nationale n'a jamais caché son animosité envers le régime vénézuélien et tous les gouvernements socialistes d'Amérique latine. Fils de Cubains émigrés aux États-Unis, il considère le régime vénézuélien comme l'un des principaux piliers du gouvernement cubain, ce qui lui donne une raison supplémentaire de détester Nicolás Maduro. Une source proche de Donald Trump a confié à Axios que « les Cubains qui entourent le président ne le laissent pas tranquille » sur cette question. Conséquence ? Maduro pourrait « finir dans un sac mortuaire ».

▲ Marco Rubio (avec un drapeau vénézuélien derrière) est l'un des critiques les plus virulents du Venezuela au sein de l'administration Trump
CRISTOBAL HERRERA/EPA
Fort de son influence au sein du cercle restreint de Donald Trump, Marco Rubio sera la figure de proue de la Maison-Blanche pour plaider en faveur d'une action plus agressive contre le régime vénézuélien. D'ailleurs, en mai 2025, le secrétaire d'État a dédié une dédicace à María Corina Machado, figure emblématique de l'opposition vénézuélienne , dans le magazine Time, qui l'a classée parmi les 100 personnalités les plus influentes de 2024. « Elle est la Dame de Fer du Venezuela. Elle incarne la résilience, la ténacité et le patriotisme. Face à des défis redoutables, María Corina n'a jamais renoncé à sa mission : lutter pour un Venezuela libre, juste et démocratique. »
Bien que Donald Trump soit influencé par Marco Rubio, certains membres de son administration et une grande partie de son électorat s'opposent ouvertement à toute action militaire américaine à l'étranger. Et ils ne verraient pas d'un bon œil une intervention de Washington au Venezuela. Comme l'analyse le professeur d'université vénézuélien Ramón Cardozo Álvarez dans un article publié dans la Deutsche Welle, « un recours manifeste à la force contre le Venezuela pourrait engendrer des tensions politiques internes au sein de la coalition soutenant le président ».
Lors des attaques iraniennes contre les États-Unis, Donald Trump a déjà signalé son possible recours à la force. Cependant, cette mesure a suscité des critiques de sa base électorale, plusieurs responsables de l'administration, comme le vice-président J.D. Vance, soulignant le caractère exceptionnel de cette mesure, qui visait uniquement à détruire le programme nucléaire iranien.
« L’usage ouvert de la force contre le Venezuela pourrait générer des tensions politiques internes au sein de la coalition soutenant le président Trump. »
Ramón Cardozo Álvarez, professeur d'université vénézuélien
En public, bien qu'il s'agisse de sa propre initiative, Donald Trump évoque à peine le déploiement de cette flotte sur les côtes vénézuéliennes. Aucune annonce n'a été faite, ni de la Maison-Blanche ni du Pentagone ; l'information a été diffusée par les médias. De plus, le président américain a choisi la procureure générale, qui a accordé des interviews à des chaînes de télévision américaines, pour incarner le siège du régime de Nicolás Maduro. C'est Pam Bondi qui a annoncé la récompense de plusieurs millions de dollars pour quiconque contribuerait à la capture du dirigeant vénézuélien.
Le choix de Pam Bondi démontre que l'approche de cette affaire n'est pas militaire, mais juridique. Le chef de l'État entend justifier ses récentes actions en considérant le dirigeant vénézuélien comme « illégitime » et « criminel narcotrafiquant », une manière d'éviter de déplaire à sa base électorale et de tenter de maintenir l'affaire relativement discrète dans les médias américains.
« Pression sur Maduro » : que peuvent bien vouloir les États-Unis avec leur présence militaire accrue ?Pour John Polga-Hecimovich, il ne fait aucun doute qu'il s'agit d'un nouvel exercice de la « politique internationale » de « diplomatie coercitive » de Donald Trump. « Je pense que ce mouvement vise à faire pression sur Maduro , mais je ne pense pas qu'il s'agisse d'une tentative à grande échelle de le renverser », résume-t-il, expliquant que la flotte actuelle est « trop petite pour faire quoi que ce soit de significatif pour renverser le régime de Maduro ».
« Je pense que cette mesure vise à faire pression sur Maduro, mais je ne pense pas qu’il s’agisse d’une tentative à grande échelle pour le faire tomber. »
John Polga-Hecimovich, professeur de sciences politiques à l'Académie navale des États-Unis, spécialisé dans les affaires latino-américaines
L'expert évoque d'autres justifications que la chute du régime. L'une d'elles est l'une des promesses de campagne de Donald Trump : la « guerre contre la drogue » et la fin de l'entrée de drogue aux États-Unis par le biais de réseaux organisés. « L'administration Trump estime que la criminalité transnationale organisée en Amérique latine représente une réelle menace pour ses intérêts », déclare John Polga-Hecimovich, ajoutant : « En donnant la priorité à la lutte contre le trafic international de drogue », le président américain envoie une « démonstration de force » à tous les cartels qui organisent l'entrée de drogue dans le pays.
John Polga-Hecimovich évoque également une autre raison : l'envoi d'un signal de force à toute l'Amérique latine. « Cela envoie un message aux dirigeants latino-américains comme Maduro : les États-Unis sont prêts à recourir à la menace de la force pour atteindre leurs objectifs et représente une occasion pour eux de démontrer leur contrôle sur leur "sphère d'influence dans les Caraïbes" », explique le professeur d'université, soulignant que cela démontre la capacité de la marine américaine à se déployer rapidement dans des régions politiquement sensibles. »
Il n'est donc pas surprenant que plusieurs dirigeants de gauche en Amérique latine aient critiqué l'action américaine. Le président colombien Gustavo Petro a déjà accusé les États-Unis d'utiliser « le trafic de drogue comme prétexte à une invasion militaire ». « Le Cartel de los Soles n'existe pas ; c'est un prétexte fictif utilisé par l'extrême droite pour renverser les gouvernements qui ne lui obéissent pas », a-t-il dénoncé, soulignant qu'en cas d'invasion, Washington transformerait le Venezuela « en une nouvelle Syrie ».

▲ Le président colombien a été l'une des voix les plus critiques de l'action américaine au Venezuela
MAURICIO DUENAS CASTANEDA/EPA
La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, qui entretient des relations cordiales avec Donald Trump malgré son orientation de gauche, a également exprimé des critiques , appelant à la fin de l'« interventionnisme » et prônant « l'autodétermination des peuples, la non-intervention et la résolution pacifique des conflits ». De même, le Brésil, par la voix de son conseiller présidentiel Celso Amorim, considère avec « inquiétude » l'envoi de navires de guerre américains au Venezuela , comme le rapporte Globo : « Je pense que la non-intervention est essentielle. »
À l’inverse, les gouvernements de droite d’Amérique latine, comme celui de Javier Milei en Argentine, louent et voient d’un bon œil les actions de Donald Trump et considèrent également le Cartel de los Soles comme une organisation terroriste, à l’instar des États-Unis.
Maduro demande le soutien de Guterres, Corina Machado le remercie et redouble son offensive contre le régimeAu Venezuela, Maduro accorde une grande importance à l'intervention militaire américaine. Non seulement en raison de l'imprévisibilité de Donald Trump et de la possibilité de la chute du régime, mais aussi pour mobiliser l'opinion publique vénézuélienne contre les États-Unis et potentiellement en tirer un avantage politique.

▲ Nicolás Maduro rend visite à l'armée
"Après 20 jours consécutifs d'annonces, de menaces, de guerre psychologique, après 20 jours de siège contre la nation vénézuélienne, aujourd'hui nous sommes plus forts qu'hier, aujourd'hui nous sommes mieux préparés pour défendre la paix, la souveraineté et l'intégrité territoriale", a déclaré jeudi Nicolás Maduro, lors d'un exercice militaire où il portait un uniforme militaire, une manière également de démontrer sa force face à ce qu'il qualifie de menaces américaines.
Des mois après avoir avoué son crime, le meurtrier de Sartawi est enfin jugé. Mais, coup du sort, le terroriste de la chambre 507 clame son innocence. Comment tout cela va-t-il finir ? « 1983 : Portugal à Queima-Poupa » raconte l'année où deux groupes terroristes internationaux ont attaqué le Portugal. Écoutez le sixième et dernier épisode de ce Podcast Plus, narré par l'actrice Victoria Guerra, avec une bande originale de Linda Martini, sur le site web d'Observador. Vous pouvez également l'écouter sur Apple Podcasts , Spotify et YouTube Music . Écoutez le premier épisode ici , le deuxième ici , le troisième ici , le quatrième ici et le cinquième ici .
Sur le plan international, le Venezuela a sollicité l'aide des Nations Unies, et plus particulièrement du Secrétaire général. Le ministre vénézuélien des Affaires étrangères, Yván Gil, a adressé ce vendredi une lettre à António Guterres, exprimant sa « profonde préoccupation » face à l'escalade de l'agression du gouvernement des États-Unis contre le Venezuela. « Ces deux dernières années, la menace pour la paix et la sécurité de l'Amérique latine et des Caraïbes a atteint un niveau sans précédent. »
Le chef de la diplomatie vénézuélienne considère inacceptable qu'au « XXIe siècle » les « politiques de force qui mettent en danger la paix et la sécurité internationales » réapparaissent, appelant Guterres à demander au gouvernement des États-Unis de « mettre fin à ces actions hostiles et de répondre pleinement à la souveraineté, à l'intégrité territoriale et à l'indépendance de la République bolivarienne du Venezuela ».

▲ Des diplomates vénézuéliens ont demandé à Guterres que les États-Unis cessent leurs provocations contre le Venezuela
MIRAFLORES PRESS / DOCUMENT/EPA
Parallèlement, pour tenter d'obtenir un soutien international, le Venezuela a discuté de la situation avec le Brésil et la Colombie. Il a également fait part de ses inquiétudes à ses alliés russe et chinois , qui ont pris la défense du régime vénézuélien. Cependant, la Chine a défendu Nicolas Maduro avec beaucoup plus d'insistance , s'opposant à « l'ingérence de forces extérieures dans les affaires intérieures du Venezuela » et critiquant directement la présidence américaine. La Russie , qui tente de s'attirer les faveurs de Donald Trump pour résoudre la guerre en Ukraine, s'est contentée d'exprimer sa « solidarité avec les dirigeants vénézuéliens et de confirmer le soutien total de Moscou » à Caracas, sans jamais critiquer les États-Unis .
Sur le plan militaire, le régime cherche à mobiliser 4,5 millions de personnes au sein de la Milice nationale bolivarienne – une force de volontaires civils créée en 2009 par l'ancien président Hugo Chávez et désormais officiellement intégrée aux Forces armées nationales bolivariennes. Il a également renforcé sa présence militaire à la frontière avec la Colombie.
À l'inverse, María Corina Machado a accordé plusieurs interviews, espérant relancer le mouvement d'opposition contre Nicolás Maduro au Venezuela. Dans X, le principal représentant de l'opposition vénézuélienne, dont la localisation reste inconnue dans le pays pour des raisons de sécurité, a remercié et salué l'action des États-Unis. « Le régime Maduro est une structure criminelle qui a causé de graves dommages au pays », a déclaré la dissidente vénézuélienne, adhérant et contribuant au discours américain.
C'est le Venezuela qui arrive !
Ici vous pouvez voir, en seulement 4 minutes, l’histoire de millions de citoyens prêts pour le retour de la démocratie et un boom économique et social jamais vu dans l’histoire de notre pays.
La transition est terminée. Vous… pic.twitter.com/7K5VykhE1B
– María Corina Machado (@MariaCorinaYA) 28 août 2025
« La transition a déjà commencé », a écrit María Corina Machado dans X ce jeudi, promettant une nouvelle ère de « retour à la démocratie » et un « essor économique et social sans précédent dans l'histoire du Venezuela ». Compte tenu de ses bonnes relations avec Marco Rubio, si le régime tombe, le leader de l'opposition devrait bénéficier du soutien des États-Unis pour occuper un poste important au sein d'un nouveau gouvernement.
Pour l'instant, une invasion du Venezuela ou une action militaire visant à renverser le régime sont encore loin d'être une réalité. « Le scénario le plus probable est que les forces navales s'engagent dans des opérations de lutte contre le trafic de drogue et finissent par retourner aux États-Unis », estime John Polga-Hecimovich. « Une attaque contre une cible militaire est moins probable, mais toujours possible », poursuit-il.
Une invasion « visant à changer de régime » serait « quasiment impensable ». « La seule chose qui pourrait déclencher une action militaire américaine serait, par exemple, une invasion du Guyana par le Venezuela », affirme John Polga-Hecimovich. Cependant, avec un secrétaire d'État ouvertement opposé à des régimes comme celui de Nicolás Maduro qui lui murmure à l'oreille, Donald Trump pourrait changer d'avis sur ce siège militaire, qui reste le plus important dans les Caraïbes depuis des décennies et dont les objectifs restent flous.
observador